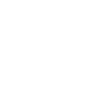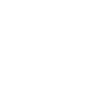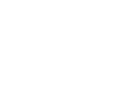L’édito de Fabrice Grosfilley : les adjectifs des objectifs
Cynique. Arrogant. Suffisant. Brutal. Violent. Grossier. Autocentré. Immoral. Agressif. Imprévisible. Je pourrais continuer encore longtemps. La liste des adjectifs qu’on pourrait appliquer au monde de Donald Trump est interminable. Interminable et peu engageante, tant cette manière de voir le monde et de faire de la politique nous éloigne de la diplomatie, du multilatéralisme, des conventions, de la recherche du consensus et du compromis. La gestion du monde n’a jamais été un monde de bisounours. Mais on retiendra de cette année 2025 que nous avons basculé dans une nouvelle manière d’agir où l’on ne s’embarrasse plus de la morale, du droit international, du respect des partenaires ou des droits de l’homme. L’homme est un loup pour l’homme, et Donald Trump est chef de meute. Sans complexe, sans états d’âme. C’est la loi du plus fort et du donnant-donnant. Et encore, si je te donne un peu, il faudra que tu me donnes beaucoup en retour. Si je peux te mettre à genoux, c’est encore mieux.
Cette nouvelle donne géopolitique vient de s’exprimer à Djeddah, en Arabie saoudite, avec la proposition d’un cessez-le-feu temporaire entre l’Ukraine et la Russie : 30 jours de cessation des combats, à prolonger si possible. Cette proposition américaine est donc acceptée par l’Ukraine. Un cessez-le-feu qui n’impliquerait donc pas que l’Ukraine récupère les territoires occupés par l’armée russe, notamment dans le Donbass, ces provinces situées au sud-est du pays. Et encore moins qu’elle récupère la Crimée annexée par la Russie en 2014. En échange, les Américains ont annoncé qu’ils reprenaient leur collaboration militaire avec l’Ukraine. Cela concerne l’envoi de matériel et de munitions, ainsi que le partage de renseignements militaires. Du matériel et des munitions déjà payés aux firmes américaines qui les produisent, il faut quand même le souligner. Et pour parachever le tout, l’Ukraine s’engage aussi à conclure dès que possible un accord sur l’exploitation des minerais ukrainiens, ces fameux métaux et terres rares sur lesquels lorgnent les Américains.
Voici donc la géopolitique réduite à un marchandage. Peu importe de savoir qui est l’agresseur et qui est l’agressé. Peu importe de savoir si l’on a affaire à une démocratie ou à un pouvoir autocrate. Peu importe de savoir si des frontières ont été violées et des terres volées. Peu importe de savoir si l’on a tué des civils, déporté des enfants, violenté des femmes, massacré des villages, terrorisé des populations, torturé des prisonniers, enfreint les lois de la guerre, détruit un patrimoine. Quand on est dans le cynisme pur, ce qui relève de la morale ou du droit n’a plus réellement cours. Seules comptent les colonnes des dépenses et des bénéfices. Il faut que ce que j’investis me rapporte. Un jour, je caresse Vladimir Poutine dans le sens du poil et j’humilie Volodymyr Zelensky. Le lendemain, je fais pression sur le premier et je me réconcilie avec le second. C’est une question d’intérêt et non de constance, encore moins de valeurs. Le plus offrant sera celui que je soutiendrai.
Cette manière de faire porte un nom : la vassalisation. Le fait de soumettre, d’asservir, de rendre dépendant, que ce soit sur le plan économique, culturel et bien évidemment militaire. La vassalisation, c’était la position de l’Europe en 1945, lorsque, libérée par les Alliés, elle ne pouvait rien refuser au grand frère américain. Ce sera demain la position de l’Ukraine, contrainte de mettre un genou à terre. La construction de l’Union européenne, ce long processus parfois chaotique mais constant, a permis de relativiser notre vassalisation. Mais le processus n’est pas arrivé à son terme. Nous dépendons toujours fortement des Américains dans toute une série de domaines. Et quand on parle des Américains, on parle non seulement du pouvoir politique, mais aussi du pouvoir économique et technologique, qui s’exprime par exemple à travers les grandes entreprises.
Et c’est ce qui va maintenant se jouer : pouvons-nous gagner en autonomie et ne plus être condamnés à la vassalisation ? Dans la vision du monde de Donald Trump, il y a les grands : les États-Unis, la Russie, la Chine. Et puis, il y a les petits, qui n’ont rien à dire. En Europe, et en Belgique en particulier, nous avons longtemps cultivé une forme d’atlantisme. Nous étions dans le camp américain, protégés par les Américains, sensibles aux intérêts américains. Mais quand le protecteur ne vous protège plus, quand il monnaye chacun de ses gestes, lui rester soumis en toutes circonstances vous fait passer de la vassalisation à l’esclavage. Si la Belgique, seule, ne peut sans doute pas rêver d’une indépendance totale, l’Union européenne, elle, peut l’envisager. Pour cela, il faudra être visionnaire, courageux, déterminé, soudé, solidaire, imaginatif, indépendant, altruiste…
Ces adjectifs-là, à tout prendre, sont un peu plus positifs que ceux que nous propose Donald Trump.
Fabrice Grosfilley