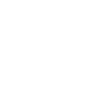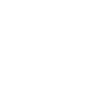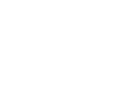L’édito de Fabrice Grosfilley : la loi du plus fort
C’est un passage en force, qui va se faire sur le dos des Ukrainiens, à peine consultés, et en snobant l’Union européenne, qui n’a même pas été informée. Voilà comment on peut résumer la séquence diplomatique que Donald Trump vient d’imposer au monde entier en s’entretenant au téléphone avec Vladimir Poutine. De cet entretien, on sait qu’il a duré 90 minutes et que les deux hommes l’ont jugé suffisamment productif pour décider de négocier immédiatement. Ils ont prévu de se voir en tête-à-tête, et cela devrait même se faire assez rapidement, bien qu’aucune date officielle n’ait encore été annoncée. Ce sommet devrait probablement avoir lieu en Arabie saoudite, a indiqué Donald Trump.
Cette rencontre, à elle seule, sera tout un symbole. Cela fait quatre ans que Vladimir Poutine n’a plus rencontré de dirigeant américain de haut niveau. La dernière rencontre avec Joe Biden, en 2021, avait été particulièrement tendue et les entretiens très courts, les États-Unis accusant la Russie de mener des cyberattaques contre leurs intérêts. Quelques mois plus tard, c’était l’invasion de l’Ukraine et la mise au ban de Vladimir Poutine.
Avec ce coup de téléphone, Donald Trump impose donc un virage à 180 degrés. Vladimir Poutine n’est plus un adversaire mais un potentiel partenaire. Il sort de son isolement diplomatique et peut se frotter les mains, puisqu’il apparaît aujourd’hui très clairement en position de force pour imposer une négociation qui sera très défavorable aux Ukrainiens. Non seulement cette première discussion sur l’Ukraine a eu lieu sans les Ukrainiens, mais Vladimir Poutine a aussi pu lister toute une série de conditions qui ne semblent pas poser de problème à Donald Trump. Le chef du Pentagone, l’équivalent d’un ministre de la Défense, Pete Hegseth, a déjà indiqué qu’une adhésion de l’Ukraine à l’OTAN n’était pas réaliste. Il a également jugé peu envisageable un retour de l’Ukraine à ses frontières d’avant 2014, c’est-à-dire avec la Crimée, annexée par Moscou. Pas d’adhésion à l’OTAN, l’annexion de la Crimée, probablement celle du Donbass. Les Ukrainiens sont en train de perdre sur toute la ligne, et ce n’est peut-être pas fini, puisque, aujourd’hui, les forces russes occupent 20 % du territoire ukrainien, et que le Kremlin insiste sur un “règlement durable” du conflit. Par règlement durable, il faut entendre le désarmement de l’Ukraine, voire le renvoi de Volodymyr Zelensky et l’installation de dirigeants favorables à la Russie.
On n’en est sans doute pas là, et Vladimir Poutine, comme Donald Trump, est capable d’exiger beaucoup pour obtenir un peu moins que ce qu’il demande. En face, les Ukrainiens sont en mauvaise posture. Leur capacité de résistance sur le plan militaire dépend des livraisons d’armes des Américains et des Européens. Et la contre-offensive en territoire russe à Koursk, visant à prendre des territoires pour les utiliser comme monnaie d’échange, est en train de reculer. Les deux tiers des territoires conquis au mois d’août ont été perdus par les Ukrainiens.
Ce matin, dans une interview au Financial Times, Emmanuel Macron met en garde contre une paix qui reviendrait à une “capitulation” de l’Ukraine. Il souligne aussi que seule l’Ukraine peut négocier avec la Russie. Ces déclarations risquent de faire l’effet d’une piqûre de moustique sur le dos d’un éléphant. Si les États-Unis et la Russie se mettent d’accord, l’Europe aura beau protester, cela finira par s’imposer à nous. Si, depuis Bruxelles, nous pouvons observer cela avec une certaine distance, l’inquiétude est désormais montée d’un cran en Pologne, dans les États baltes, en Finlande, en Suède, dans tous ces pays proches de la Russie et qui pourraient un jour être une cible de son expansionnisme. L’Ukraine, c’est un domino. S’il tombe, on ne peut pas exclure que la Russie cherche alors à pousser son avantage un peu plus loin.
C’est le nouveau monde que Donald Trump nous impose. Un monde où les concepts de communauté internationale et de coopération multilatérale appartiennent au passé. Pour Donald Trump, seuls les États comptent. Le droit international, les Nations unies, la Cour pénale internationale, et même l’Organisation mondiale du commerce, tout cela, c’est de la littérature. Quand les règles de droit ne sont plus respectées, c’est le rapport de force qui les remplace. La raison du plus fort est toujours la meilleure. On ne sait pas si Donald Trump a lu Les Fables de La Fontaine. Mais on a bien conscience que, dans cette nouvelle donne, l’Union européenne ressemble à un agneau.