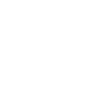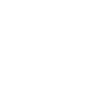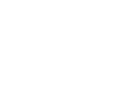L’édito de Fabrice Grosfilley : prendre l’insécurité par tous les bouts
Dans son édito de ce jeudi 06 février 2025, Fabrice Grosfilley revient sur les événements à Clémenceau.
Quelques images de vidéosurveillance, un métro à l’arrêt, et le débat s’emballe. L’apparition de deux hommes armés de fusils automatiques, hier matin, à la station Clémenceau a ramené à la une de l’actualité la question de la sécurité. Pas parce que ce serait la première fois que des coups de feu sont tirés en Région bruxelloise — à peu près au même moment, il y a aussi eu des coups de feu à Saint-Josse qui ont fait deux blessés par balle et dont on a finalement beaucoup moins parlé — mais parce que les images de la station Clémenceau ont frappé nos esprits et alimenté les peurs.
C’est vrai qu’elles sont choquantes, ces images où l’on voit deux hommes sortir d’une station de métro, tirer des coups de feu en direction d’une cible dont on se demande ce qu’elle était, puis retourner dans le métro et disparaître dans les tunnels.
Oui, aujourd’hui, à Bruxelles, comme à Anvers et sans doute dans beaucoup d’autres zones du pays, des malfaiteurs ont recours à des armes de guerre. Et oui aussi, la guerre des gangs se livre en plein jour, sur un théâtre d’opération qui est la ville en elle-même, avec le risque que ceux qui y travaillent, y vivent, s’y déplacent, soient des témoins directs de ces règlements de comptes et autres opérations d’intimidation. Notre choc, hier matin, réside dans la puissance de ces images et dans la prise de conscience qu’une fusillade de ce type peut désormais survenir à tout moment, que nous pourrions tous y être confrontés, et que le risque d’une balle perdue, qui ôterait la vie d’un citoyen se trouvant au mauvais endroit au mauvais moment, ne doit pas être minimisé.
► Voir aussi : Nouveaux tirs à Clémenceau : le blessé, un ouvrier, est une victime collatérale
Une fois ce constat posé, on doit surtout se poser la question de notre réaction. Que font les autorités pour endiguer le phénomène ? Que peuvent-elles faire ? Qu’ont-elles négligé de faire ? Sur la seule année 2024, on a compté près de 90 fusillades à Bruxelles, avec 9 morts. C’est un chiffre record. En 2022, on était à 3 morts pour 56 fusillades ; en 2023, 4 morts pour une soixantaine de faits recensés. Le phénomène s’accélère, c’est donc très clair. Les autorités sont-elles restées sans réaction ? Non. On sait que la police judiciaire consacre désormais plus d’un quart de ses moyens à la lutte contre le trafic de drogue. Les autorités bruxelloises ont de leur côté mis en place une politique de “hot spot”, qui permet de contrôler davantage certains quartiers dans l’idée de faire pression sur les dealers, mais aussi sur leurs consommateurs. Est-ce suffisant ? Absolument pas, on en a eu la preuve hier encore.
Que faut-il faire ? D’abord, renforcer les effectifs de la police fédérale. Parce qu’on peut facilement jeter l’opprobre sur Bruxelles ou même tenter de faire un lien avec les blocages politiques en cours, mais tous ceux qui sont un peu de bonne foi reconnaîtront que cela n’a rien à voir. À Anvers aussi, il y a des fusillades et des attaques à la grenade. Ce n’est pas la faute des autorités anversoises. À Marseille, les règlements de compte sont fréquents, et on ne se dit pas que c’est la faute du maire de la ville. La lutte contre la criminalité dépasse les frontières locales ou régionales. Il est possible que les auteurs des coups de feu d’hier soient aujourd’hui loin de la station Clémenceau, peut-être même à l’étranger.
Outre le renforcement de la police fédérale, qui semble une évidence, puisque c’est bien elle et non les zones de police locale qui est en charge de la lutte contre le grand banditisme, on rappellera que la commissaire aux drogues, Ine Van Wymersch, a fait, il y a un peu plus d’un an, toute une série de recommandations. Cela va de la possibilité de pratiquer des écoutes à la saisie de véhicules ou de biens immobiliers dont on ne pourrait pas prouver qu’ils ont été achetés avec de l’argent légitimement gagné. Les grands trafiquants connaissent les ficelles : ils opèrent depuis l’étranger, et ils sont aussi, par définition, les rois du blanchiment d’argent et de l’évasion fiscale.
Si on veut rendre les rues plus sûres, on doit aussi poser la question de la vente d’armes. Comment faire pour qu’il ne soit effectivement pas possible d’acheter un kalachnikov ou une arme de poing ? Sommes-nous prêts, par exemple, à rétablir des contrôles aux frontières pour permettre à la police d’ouvrir les coffres et de fouiller les bagages ? Ce sont des questions qu’on pourrait soulever.
Enfin, il y a un aspect qu’on néglige souvent dans ce débat, c’est celui de la prévention. Comment se fait-il que les dealers puissent trouver autant de débouchés ? Pourquoi y a-t-il autant de clients, en Belgique et plus largement dans toute l’Union européenne ? Comment faisons-nous pour limiter la demande ? Pourquoi est-il finalement plus intéressant de risquer sa vie en vendant de la drogue que de décrocher un diplôme et travailler honnêtement ? D’où vient cette main-d’œuvre qui n’a rien à perdre ? Derrière le commerce de la drogue, il y a des questions sanitaires et sociales. Se contenter de surfer sur l’aspect sécuritaire, c’est se condamner à ne jamais résoudre le problème.
Fabrice Grosfilley