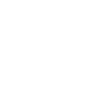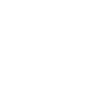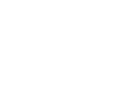L’édito de Fabrice Grosfilley : le mur budgétaire derrière le mur politique
L’argent. C’est le nerf de la guerre. C’est aussi le carburant indispensable de l’action publique. Faire de la politique, c’est aussi savoir comment prélever et utiliser l’argent pour nous permettre de faire société. Les impôts d’un côté, la construction d’écoles, de routes, la sécurité, mais aussi les pensions, la santé, la correction des inégalités sociales de l’autre. Selon qu’on est de gauche ou de droite, on voudra que l’État intervienne plus ou moins en faveur de la collectivité.
Venue des États-Unis, la tendance libertarienne voudrait aujourd’hui que nos États se limitent au strict minimum. Pensions, santé, éducation, mobilité, communication et même sécurité ou exploration spatiale : “laissons faire le marché”, disent les tenants du libéralisme économique débridé. Sécurité sociale, transports publics, respect de l’État de droit et puissance publique, sans oublier la recherche et la culture : “on ne peut pas tout confier au marché”, répondent les défenseurs du modèle européen.
Car changer de modèle et tout détricoter, c’est le grand virage que nous suggèrent Elon Musk ou JD Vance. Et peu à peu, ces idées, ce modèle, gagnent du terrain. Insidieusement, sans qu’on en débatte vraiment, c’est bien le modèle de société européen qui est en train d’être remis en cause. Les plus savants parleront du capitalisme rhénan, qui se distingue du capitalisme anglo-saxon. Dans le modèle rhénan, on vise des relations à long terme entre clients, fournisseurs et employés, le patronat et les syndicats entretiennent une relation de partenariat pour limiter les conflits sociaux, et un système de protection sociale ainsi qu’une politique de stabilité monétaire complètent le tout.
Ce modèle peut-il être amélioré ? Sûrement. Est-il encore finançable ? C’est une question importante. “Non”, auront tendance à répondre les tenants du libéralisme extrême : alors laissons faire le marché. “C’est soutenable, à condition que tout le monde contribue et qu’on ne permette pas aux plus riches – qu’il s’agisse de particuliers ou de grandes multinationales installées à l’étranger – d’éluder l’impôt”, répondent ceux qui défendent le modèle européen.
Dans le débat qui a accompagné la formation du gouvernement en Arizona, vous pourrez retrouver les partisans des deux thèses. Il est parfois utile de dézoomer quand on veut comprendre les débats budgétaires, politiques ou économiques. Cela peut sembler abstrait : tendance libertarienne, keynésianisme, modèle rhénan… Mais sans ces notions en tête, on a parfois du mal à s’y retrouver et à comprendre où veulent en venir les uns et les autres. Derrière un chiffre, derrière une déclaration, c’est bien souvent un projet de société qui se dessine.
Maintenant que nous avons dézoomé, je vous propose de faire l’exercice inverse. Zoomons, et offrons-nous un gros plan sur ce qui se passe à la Région bruxelloise. Avec une déclaration du ministre bruxellois des Finances, en affaires courantes, Sven Gatz, au Parlement bruxellois hier. Une déclaration qui sonne comme une mise en garde : face à l’impasse budgétaire, “seul un nouveau gouvernement doté des pleins pouvoirs peut procéder aux réformes nécessaires et éviter le pire”. Le ministre était interrogé sur l’évolution du budget régional . “La différence entre le gouvernement bruxellois et le Titanic, c’est que le Titanic n’a pas vu l’iceberg ou l’a vu beaucoup trop tard. Le gouvernement bruxellois, lui, navigue tout droit vers l’iceberg”, a ainsi indiqué Sven Gatz. “Seul un nouveau gouvernement peut encore éviter une collision aux conséquences désastreuses.”
Et Sven Gatz d’annoncer des chiffres : le résultat financier du budget 2024 se serait à nouveau détérioré de 10 % par rapport aux prévisions, avec un déficit passant de -1,315 milliard à -1,451 milliard. Une détérioration principalement due à des recettes fiscales moins importantes. Le ministre du Budget a donc également appelé le Parlement à ne pas effectuer de dépenses supplémentaires lors du prochain vote des douzièmes provisoires.
Voilà pour l’avertissement de Sven Gatz. Il est évidemment important. Il indique que la Région bruxelloise n’est pas très loin de se prendre un mur budgétaire. Pour éviter ce mur budgétaire, il faudrait un gouvernement qui fasse des économies. Pour qu’on ait un gouvernement, il faudrait d’abord qu’on évite le mur politique qui attend David Leisterh à la fin de la semaine. Pour l’instant, le formateur n’a toujours pas donné le coup de volant qui lui permettrait d’éviter d’aller dans le mur.
Ces deux murs, ou ces deux débats sur ce qui est politiquement possible et budgétairement souhaitable, sont en réalité intimement liés. C’est ça, le débat que nous devrions avoir entre Bruxellois. Quelles sont les politiques que nous voulons préserver ? Quelles sont celles dont nous pouvons nous passer ? Quelles en seraient les conséquences sociales et comment financer le tout ? Capitalisme rhénan ou modèle libertarien ?
Ce débat, nous ne l’avons pas. Il est occulté par des questions de personnes et de stratégie politicienne. A moins qu’on ait décidé sciemment de laisser pourrir la situation pour que le modèle rhénan ne soit plus praticable une fois que les institutions politiques seront paralysées ou hors-jeu. Sauf miracle, Bruxelles va donc se prendre les deux murs l’un après l’autre. Le mur politique, suivi du mur budgétaire. Après, il y aura probablement un mur social, parce qu’il ne faut pas croire que les remèdes libertariens, dans une ville où 25 % des habitants vivent sous le seuil de pauvreté, ne seraient pas sans conséquence. Avec le risque qu’après avoir percuté deux ou trois murs de suite, la Région ne soit plus très belle à voir.